





En France, pour des raisons culturelles et historiques, la notion de racisme environnemental peine à émerger. Il existe bien des statistiques ethniques produites par l’INSEE pour mesurer les discriminations, mais elles ne prennent pas en compte les inégalités environnementales. Les rares études sur le sujet ont été menées par Lucie Laurian en 2008 et 2014. La dernière étude, publiée par le Journal of Environmental Planning and Management démontre qu’en France, chaque pourcentage supplémentaire de la population d’une ville né à l’étranger augmente de 29% les chances pour qu’un incinérateur à déchets, émetteur de divers types de pollutions, y soit installé. Ce n’est que récemment que la notion de racisme environnemental est apparue dans la sphère écologiste française, en lien avec le mouvement pour une écologie décoloniale et l’actualité du mouvement Black Lives Matter.

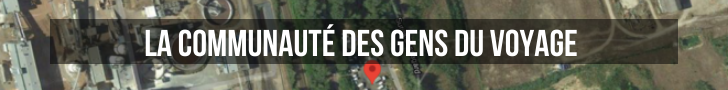




Les minorités ethniques ne sont pas seulement affectées dans leur qualité de vie sur leur lieu de résidence, mais également par leurs conditions de travail. Les populations racisées sont reléguées aux emplois les plus exposés aux pollutions : nettoyage, tri des déchets, transport logistique, peinture en bâtiment, travail saisonnier dans le secteur agricole etc. Aujourd’hui en France, plus de deux tiers des travailleurs immigrés sont des ouvriers ou des employés. L’intersection entre la classe sociale et l’appartenance à une minorité ethnique rend difficile la mesure des inégalités raciales et donc du racisme environnemental. Le débat classe/race est encore vif dans les sciences sociales en France.

La convergence entre les luttes antiracistes et écologistes commence à peine à émerger en France ou des alliances entre différents mouvements se tissent malgré de fortes réticences. La notion de racisme environnemental suscite également un intérêt croissant dans le milieu universitaire. Pour certain·e·s militant·e·s, les apports de la justice environnementale et du concept de racisme environnemental permettent de rendre plus concrètes les luttes pour la protection de l’environnement et du climat et de sortir de l’entre-soi du mouvement écologiste.
Aller plus loin
- What is environmental racism?
- Ensemble, nous demandons justice : pour en finir avec les violences environnementales, Marie Toussaint et Priscillia Ludosky
- Reportage de l’Alter JT de 2015, Avec des explications de Razmig Keucheyan, Eros Sana, Jade Lindgaard
- Mediapart live, Chlordécone : “Cette contamination est une atteinte au corps des Antillais”, avec Audrey Célestine et Malcolm Ferdinand, 20 février 2019
- Arte Décryptage “Gens du Voyage : l’enfer des aires d’accueil”
- Collectifs des femmes d’Hellemmes-Ronchin, “Nos poumons, c’est du béton !”
- La Nature est un champ de bataille, Razmig Keucheyan
- Emission “point de rupture”, Terrestre et Mediapart, Décoloniser l’écologie